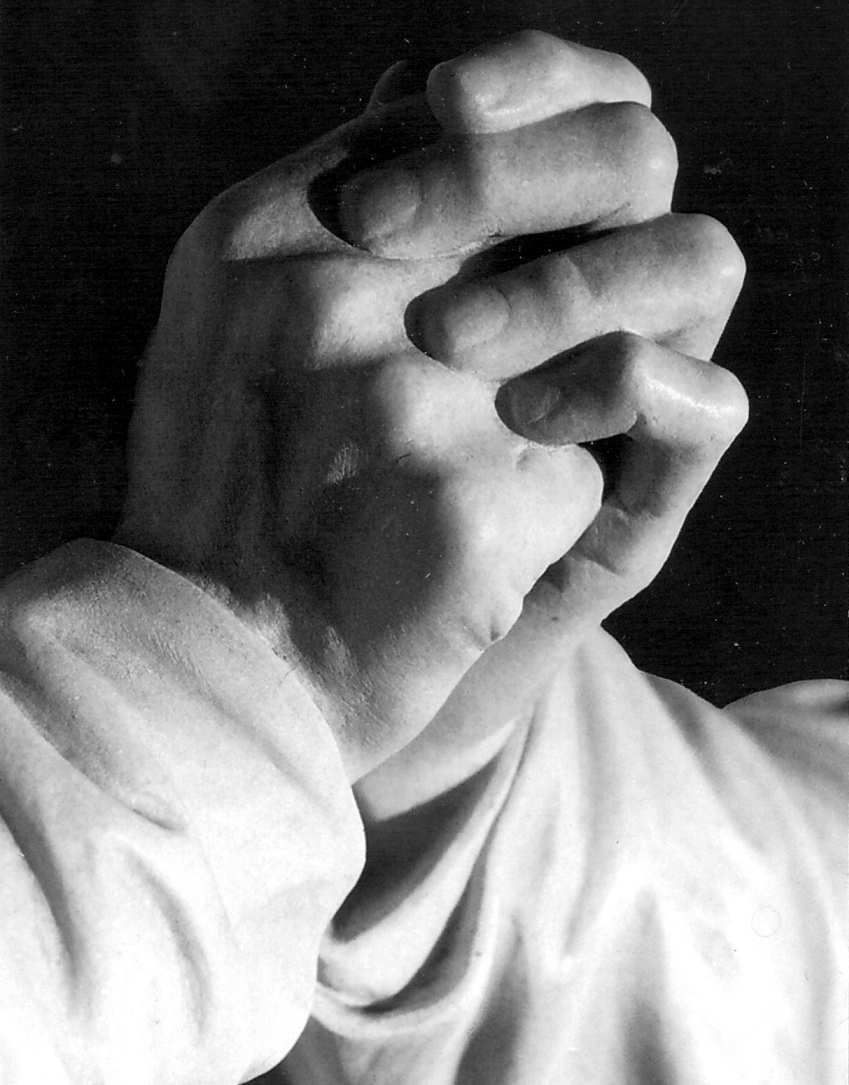
Le sens de la prière pour les défunts
Cette année, à cause du calendrier, la messe dominicale ne sera pas celle du 31e Dimanche du Temps Ordinaire mais celle des défunts et il y aura plusieurs lectures possibles entre lesquels les célébrants et les assemblées choisiront. C’est pourquoi les échos que je vous propose aujourd’hui ne prendront pas comme point de départ un passage des Écritures, mais le sens même de cette « mémoire des fidèles défunts », qui ne va pas de soi, comme vous allez voir.
C’est d’ailleurs un trait frappant qu’il faut commencer par relever : on chercherait difficilement dans l’Ancien et le Nouveau Testament un texte très clair sur le sujet. Nos frères protestants ne manquent pas de nous le faire remarquer. Cherchons à comprendre pourquoi.
Les Hébreux vivaient dans un monde où le contact avec l’Au-delà occupait une place très importante : en Égypte surtout, d’innombrables monuments, et jusqu’aux plus prestigieux comme les Pyramides, étaient destinés à préserver la mémoire de défunts, à assurer la conservation de leur corps et à accompagner leurs âmes, malgré les obstacles qu’elles pouvaient rencontrer, jusqu’aux demeures heureuses de l’Au-delà.
Bien sûr, on rencontre chez certains la perspective d’un jugement après la mort, le bonheur de l’Au-delà n’est donc pas livré sans plus au seul désir de l’homme. Mais, en Egypte justement, on voit s’étaler une démesure magique qui confie à des formules incantatoires la possibilité d’ensorceler le tribunal, si bien que, quoiqu’on ait fait, on soit assuré de franchir sans encombre l’étape du jugement.
Il semble que très vite la Bible ait pris parti contre cette tendance à s’imaginer la vie après la mort comme une prolongation du présent, fournissant le moyen d’assouvir le désir très humain de repos et de plaisir. La coupure est totale et Dieu seul est le maître de la vie et de la mort. Nous n’avons aucune prise sur le futur. C’est pourquoi on trouve des formules qui nous choquent comme celle-ci : « les morts ne louent pas le Seigneur » (Ps 87 (88), 6).
La promesse de la Résurrection qu’on voit poindre à la fin de l’Ancien Testament ne contredit pas cette mise en garde. La résurrection n’est pas ce que l’homme imagine et désire spontanément, elle est une grâce inespérée dont Dieu a le secret.
Évidemment avec le Nouveau Testament, cette promesse de la Résurrection prend une tout autre ampleur, en lien avec l’attente du retour du Christ et le jugement général qui l’accompagnera. Le sort individuel de ceux qui sont morts dans le temps intermédiaire qui nous sépare encore du terme occupe moins l’attention. On voit pourtant apparaître, notamment avec saint Paul (Philippiens 1,32), la perspective d’une rencontre avec le Christ dès la mort. Dans la suite, l‘Église guidée par l’Esprit Saint, en dira un peu plus sur le sort des âmes des fidèles défunts, on parlera d’un jugement particulier menant les uns au bonheur éternel (qui est la vision de Dieu mais pas encore la résurrection), les autres à la damnation éternelle, avec la possibilité (pour ceux dont l’adhésion au Christ n’aura pas totalement transformé la vie) de franchir une étape de purification pour laquelle nous pouvons les aider de notre prière.
Mais il ne faut pas que nous revenions à l’erreur du paganisme qui consiste à transposer sur l’Au-delà nos désirs et nos phantasmes. Sans doute nous souhaitons pour tous ceux que nous aimons qu’ils atteignent le plus vite possible le bonheur du ciel, mais faut-il pour autant les canoniser tout de suite et dire « il (elle) est près du Bon Dieu ». Qu’est-ce que nous en savons ? Eux comme nous, nous devons attendre la décision de Dieu qui est plus juste et plus miséricordieux que nous. Toute appropriation de l’Au-delà sent mauvais. Elle a l’odeur de ces rafistolages tout humains par lesquels nous essayons de concilier la Parole de Dieu avec notre intérêt. Ne donnons pas ce spectacle. Si notre espérance du ciel ne repose que sur notre désir, elle n’est pas très sérieuse.


