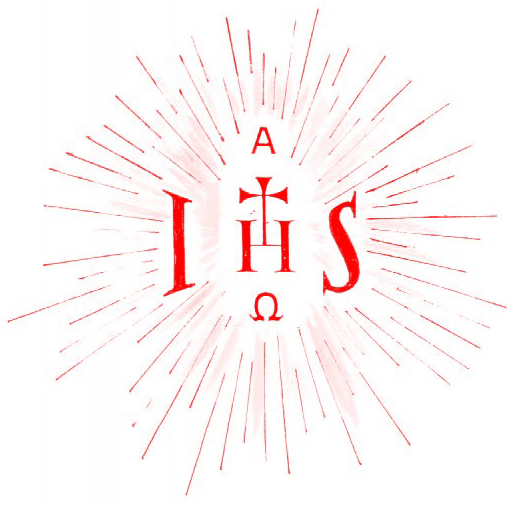
Monothéismes
Il est assez courant aujourd’hui de soutenir que le monothéisme d’Israël serait assez tardif et daterait de la dernière période de la royauté à Jérusalem ou même de l’exil à Babylone. Car c’est alors seulement qu’on trouve des énoncés comme « vous n’êtes rien et vos œuvres néant » adressés aux divinités étrangères (Isaïe 41,24) et du Dieu d’Israël : « il est le Dieu éternel, il a créé les confins de la terre » (Isaïe 42,28). Auparavant, on ne se serait pas posé la question de l’unicité divine, affirmant seulement qu’en Israël, il ne fallait honorer qu’un seul Dieu (« hénothéisme »).
La première lecture de ce dimanche appartient au cycle d’Elie-Elisée, renfermant des évènements qui se sont produits au 8e siècle avant notre ère, donc près de deux siècles avant ce qu’on a appelé malencontreusement « l’invention du monothéisme ». Nous y trouvons non seulement l’affirmation qu’il n’y a qu’un seul Dieu au ciel et sur la terre, mais que le Dieu d’Israël est précisément ce Dieu-là. Et ce, dans la bouche d’un païen, qui reconnaît donc que ses divinités nationales ne sont que du vent !
Arrêtons-nous une seconde sur son geste, voilà ce qu’il déclare : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays (Israël) autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » Cet homme a donc un sens très concret de la souveraineté du seul vrai Dieu, puisqu’il ne veut plus offrir, même quand il sera dans son pays, de sacrifice à Dieu que sur la terre d’Israël. Certains diront : « c’est bien matériel ! Dieu est partout, il n’y a pas besoin de l’humus d’Israël pour faire une offrande valable ! » Certes, mais cette résolution prouve que sa prière ne va pas s’adresser à n’importe quel principe abstrait, une idée de Dieu impersonnelle et floue, ce qu’il retient, c‘est le Dieu qui agit en Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu qui invite à sa table tous ceux qui se laissent toucher par lui.
Méfions-nous de ce que nous disons quand nous parlons de « monothéisme », surtout si on en fait un fourre-tout où l’on mettra pêlemêle : judaïsme, islam et christianisme. Reprenons par le commencement : face à une vision pauvre du divin, celle de l’antique paganisme, qui déifiait les forces de la nature et attribuait à la divinité toutes les faiblesses de l’homme, il y a eu d’abord la réaction des philosophes comme Platon ou d’autres qui ont élaboré une vision très spirituelle du divin, de l’Un qui transcende tout, mais qui n’a pas beaucoup de sang dans les veines. Le chemin de la Bible a été différent : le Dieu qui dépasse tout, devant lequel les anges eux-mêmes parlent en tremblant, il est aussi celui qui a pris parti pour un peuple, qui s’est lié à une histoire particulière et qui, comble d’audace, s’est identifié à une chair humaine pour venir chez nous et nous délivrer de l’esclavage du Mal !
C’est cela notre monothéisme : le Dieu unique devant lequel nous nous inclinons, c’est le brasier d’amour du Père et du Fils et du Saint Esprit. Et ce Dieu s’est fait chair et nous pouvons très légitimement ramener après un pèlerinage en Terre Sainte un souvenir de Bethléem qui nous rappellera que notre Dieu a fait ce chemin-là pour nous !


